Avec la montée fulgurante des intelligences artificielles comme ChatGPT, Claude ou Gemini, nombreux sont les étudiants tentés de déléguer une partie, voire l’intégralité, de la rédaction de leur mémoire à ces outils.
L’idée est séduisante : gain de temps, fluidité rédactionnelle, aide à la structuration.
Mais cette facilité apparente masque une série de risques majeurs que beaucoup sous-estiment.
Plagiat, annulation de mémoire, sanctions disciplinaires, impossibilité de défendre son travail…
L’usage de l’IA dans le cadre académique est strictement encadré, et son utilisation à mauvais escient peut coûter très cher.
Dans cet article, nous allons détailler les véritables dangers liés à la rédaction d’un mémoire avec une IA, vous présenter des exemples concrets de sanctions, et vous expliquer comment utiliser ces outils de manière responsable si vous souhaitez les intégrer à votre démarche de travail.
Un mémoire n’est pas censé être rédigé par une IA
Les universités sont claires : un mémoire doit être le fruit du travail personnel et original de l’étudiant.
Toute aide extérieure non déclarée, y compris d’origine numérique, constitue une fraude académique.
La charte des examens de nombreuses universités stipule que « toute production doit être réalisée sans assistance non autorisée ».
En cas d’infraction, les sanctions sont lourdes :
- annulation du mémoire ou de la soutenance,
- note d’ajournement,
- interdiction temporaire de se présenter à un examen,
- voire exclusion définitive de l’établissement.
Ces mesures ne sont pas théoriques.
Elles sont déjà appliquées dans de nombreux établissements, et les cas détectés sont en augmentation depuis l’émergence des outils d’IA générative.
En plus des sanctions institutionnelles, un étudiant peut voir sa crédibilité entachée de manière durable.
Dans un monde où les diplômes sont un marqueur essentiel de compétence, une annotation disciplinaire ou un dossier marqué par une fraude peut compromettre l’accès à certaines écoles ou à des postes exigeants.
L’usage de l’IA, mal encadré, devient alors un pari dangereux aux conséquences lourdes.
Utiliser ChatGPT pour rédiger son mémoire, c’est du plagiat
Le plagiat est défini par le Ministère de l’Enseignement supérieur comme « le fait de reproduire ou d’utiliser les écrits d’autrui sans les citer ».
Même si ChatGPT ne copie pas un texte existant mot pour mot, il produit un contenu qui ne provient pas de vous, mais d’un modèle statistique.
Ce contenu n’est donc pas personnel, ce qui le classe dans la catégorie du plagiat aux yeux des institutions.
C’est une erreur fréquente de penser que générer un texte « unique » via une IA suffit à contourner les règles.
En réalité, si vous soumettez un texte que vous n’avez pas rédigé vous-même – même s’il n’existe nulle part ailleurs –, vous commettez un plagiat académique.
Et cette faute est sanctionnée au même titre qu’un copier-coller depuis Wikipédia.
Les établissements mettent à jour leurs règlements pour intégrer explicitement ces cas, car l’argument « ce n’est pas copié, c’est généré » ne tient plus juridiquement ni pédagogiquement.
La responsabilité de l’étudiant est engagée dès lors qu’il remet un travail supposé être personnel.
L’argument de l’ignorance ou de la bonne foi n’est pas toujours retenu par les commissions disciplinaires.
Les outils de détection sont de plus en plus puissants
Face à la montée des fraudes liées à l’IA, les établissements ont commencé à s’équiper d’outils de détection spécialisés.
En plus des logiciels anti-plagiat classiques comme Compilatio ou Turnitin, qui peuvent signaler les textes suspects, des outils spécifiques comme GPTZero, AI Content Detector ou Crossplag sont aujourd’hui capables d’analyser :
- les tournures linguistiques typiques de l’IA,
- les répétitions de structure,
- l’uniformité du style,
- et la faible cohérence argumentative.
Ces détecteurs ne se basent pas sur la comparaison avec une base de données, mais sur une analyse du style rédactionnel, ce qui les rend très efficaces pour repérer des textes générés automatiquement.
Plusieurs universités ont d’ailleurs intégré ces outils à leurs procédures de vérification des mémoires.
Selon une enquête publiée en 2024 par le Chronicle of Higher Education, 78 % des enseignants et administrateurs interrogés ont déclaré avoir constaté une augmentation de l’usage de l’IA dans les travaux étudiants par rapport aux années précédentes (source ).
Une lecture possible de ce chiffre est que les enseignants développent une sensibilité croissante à la détection du contenu généré par IA.
En analysant le style, la structure et l’uniformité du langage, ils deviennent plus aptes à reconnaître un texte artificiel, même sans outil spécialisé.
C’est dire si l’illusion est fragile.
De plus, certains établissements forment désormais leurs correcteurs à la reconnaissance des signatures linguistiques de l’IA, rendant la fraude encore plus risquée.
Exemples réels & sanctions appliquées pour usage de l’IA dans les travaux universitaires
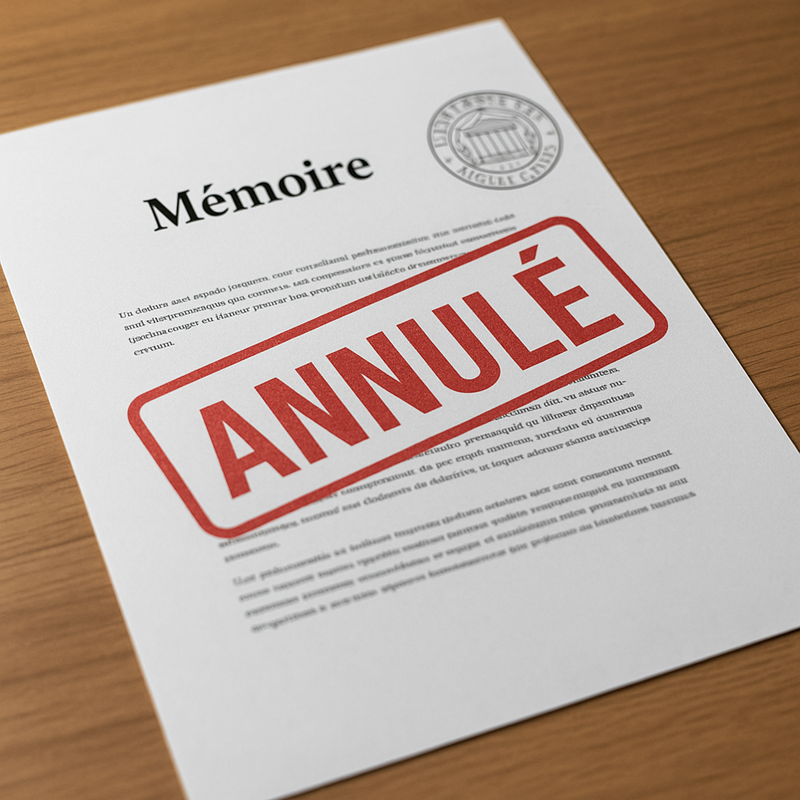
Des faits récents illustrent parfaitement les conséquences réelles de l’usage non autorisé de l’IA dans un contexte académique.
En 2023, un étudiant du Massachusetts a été sanctionné après avoir utilisé de manière abusive un outil d’IA pour rédiger un devoir scolaire.
L’établissement lui a attribué un zéro, a infligé une retenue et l’a exclu temporairement d’un programme honorifique. Ses parents ont porté l’affaire en justice, estimant la sanction exagérée.
Le tribunal fédéral saisi a tranché en faveur de l’établissement, considérant que les sanctions étaient justifiées.
La cour a estimé que même en l’absence de règlement interdisant explicitement l’usage de l’IA, le travail attendu devait être personnel, et que l’élève avait violé cet engagement implicite (Source).
Cette affaire montre que l’usage de ChatGPT n’est pas qu’une « aide technique » : aux yeux de la justice comme des institutions, il s’agit bel et bien d’un acte répréhensible lorsqu’il est utilisé sans encadrement.
Elle confirme que les sanctions peuvent être confirmées par la voie juridique, et pas seulement disciplinaire.
Et si cela vaut pour un devoir secondaire, qu’en serait-il pour un mémoire, document de fin d’études capital ?
D’autres cas concrets à travers le monde confirment cette tendance :
Université de Strasbourg (France, 2023) :
une vingtaine d’étudiants ont été sanctionnés après avoir utilisé ChatGPT lors d’un QCM d’histoire du Japon.
L’université a annulé l’épreuve concernée et exigé un rattrapage en présentiel. Ce fut l’un des premiers cas identifiés publiquement en France.
Université d’Uppsala (Suède, 2023) :
un étudiant a été reconnu coupable de triche après avoir utilisé ChatGPT pour rédiger trois devoirs.
Il a reçu un avertissement officiel de la commission disciplinaire. Ce fut la première sanction officielle liée à l’IA dans cette université.
Université de Bolton (Royaume-Uni, 2023) :
un étudiant a utilisé ChatGPT pour générer un essai, y incluant des références fictives.
Il a été sanctionné par l’annulation de sa note et a dû repasser son devoir.
Le cas a été largement médiatisé au Royaume-Uni comme exemple de triche via IA.
Ces affaires réelles montrent que les universités, en France comme à l’étranger, ne prennent pas à la légère l’utilisation non autorisée de l’intelligence artificielle.
Elles prouvent que les sanctions ne sont ni rares ni hypothétiques, et que l’argument de la nouveauté technologique ne suffit plus à excuser ce qui est considéré comme une fraude académique.
Cette affaire montre que l’usage de ChatGPT n’est pas qu’une « aide technique » : aux yeux de la justice comme des institutions, il s’agit bel et bien d’un acte répréhensible lorsqu’il est utilisé sans encadrement.
Elle confirme que les sanctions peuvent être confirmées par la voie juridique, et pas seulement disciplinaire.
Et si cela vaut pour un devoir secondaire, qu’en serait-il pour un mémoire, document de fin d’études capital ?
ChatGPT, Gemini et Claude ne peuvent pas faire votre analyse empirique
Un mémoire académique ne se résume pas à un texte bien écrit.
Il s’appuie aussi – et surtout – sur une démarche de recherche personnelle, incluant :
- des entretiens avec des professionnels,
- des questionnaires analysés par vos soins,
- des observations ou études de cas sur le terrain,
- une interprétation critique de données collectées.
ChatGPT ne peut ni aller sur le terrain, ni vous remplacer dans l’analyse.
Il ne peut pas non plus adapter ses réponses à un contexte local, ni tenir compte des nuances propres à votre sujet ou aux réalités culturelles que vous étudiez.
Un mémoire rédigé uniquement avec l’IA est donc incomplet. Et cela se voit.
Lors des soutenances, de nombreux étudiants ayant abusé de l’IA sont incapables de justifier leurs choix, de répondre aux questions ou de commenter des résultats qu’ils n’ont pas eux-mêmes produits.
De plus, les encadrants connaissent les sujets traités et les spécificités des approches exigées.
Une rédaction trop générique ou trop bien rédigée sans justification méthodologique est rapidement suspecte.
Cela nuit à votre crédibilité et peut entraîner une enquête académique.
Même si vous ne vous faites pas prendre, vous passez à côté de l’essentiel
Le mémoire est un exercice pédagogique conçu pour vous faire progresser.
Le rédiger vous-même vous permet de développer :
- votre esprit critique,
- vos capacités rédactionnelles,
- votre autonomie méthodologique,
- votre capacité à synthétiser des informations complexes.
Utiliser l’IA pour effectuer le travail à votre place peut sembler être un raccourci, mais c’est en réalité un frein à votre apprentissage.
Et ce manque de maîtrise finit par se voir, en particulier lors des soutenances orales où l’on attend de vous que vous défendiez votre démarche.
Ce que vous n’avez pas intégré, vous ne saurez pas l’expliquer.
Et cela se ressent aussi dans votre vie professionnelle.
De plus en plus d’entreprises cherchent à recruter des jeunes diplômés capables d’autonomie intellectuelle et de prise de recul – pas des techniciens dépendants d’une machine pour produire de la pensée.
Comment utiliser l’IA sans tomber dans la tricherie ?

L’IA peut néanmoins être utilisée de manière responsable, à condition de respecter certaines règles :
✅ Ce que vous pouvez faire :
- demander à ChatGPT de reformuler un paragraphe que vous avez écrit,
- l’utiliser pour générer des plans ou des idées de titres,
- corriger votre orthographe ou améliorer la fluidité de vos phrases,
- trouver des pistes de recherche ou des définitions provisoires.
❌ Ce qu’il ne faut jamais faire :
- lui demander de rédiger une partie entière du mémoire à votre place,
- inventer des citations ou des références bibliographiques,
- copier-coller des contenus générés sans les comprendre ou les adapter.
La clé est simple : vous devez rester l’auteur de votre travail.
L’IA peut être un assistant, pas un rédacteur.
Et si vous l’utilisez, signalez-le à votre encadrant, notamment dans la section « méthodologie ».
Conclusion
L’utilisation de l’IA pour la rédaction des mémoires est un sujet sensible, encadré par des règles strictes.
Ce qui peut sembler être une astuce de productivité devient très vite une infraction académique passible de lourdes sanctions.
L’exemple de l’étudiant sanctionné judiciairement pour avoir utilisé une IA dans un devoir scolaire montre que la tolérance est désormais nulle face à ces pratiques.
Entre le risque de plagiat, la détection par des outils spécialisés, l’incapacité à produire un travail de terrain et la perte d’apprentissage, les inconvénients l’emportent largement sur les bénéfices.
Notre conseil : si vous souhaitez utiliser ChatGPT, faites-le de manière encadrée, ponctuelle et transparente.
Un mémoire imparfait mais sincère, rédigé avec vos mots et vos réflexions, aura toujours plus de valeur – académique comme professionnelle – qu’un texte creux, lisse et dangereux.










