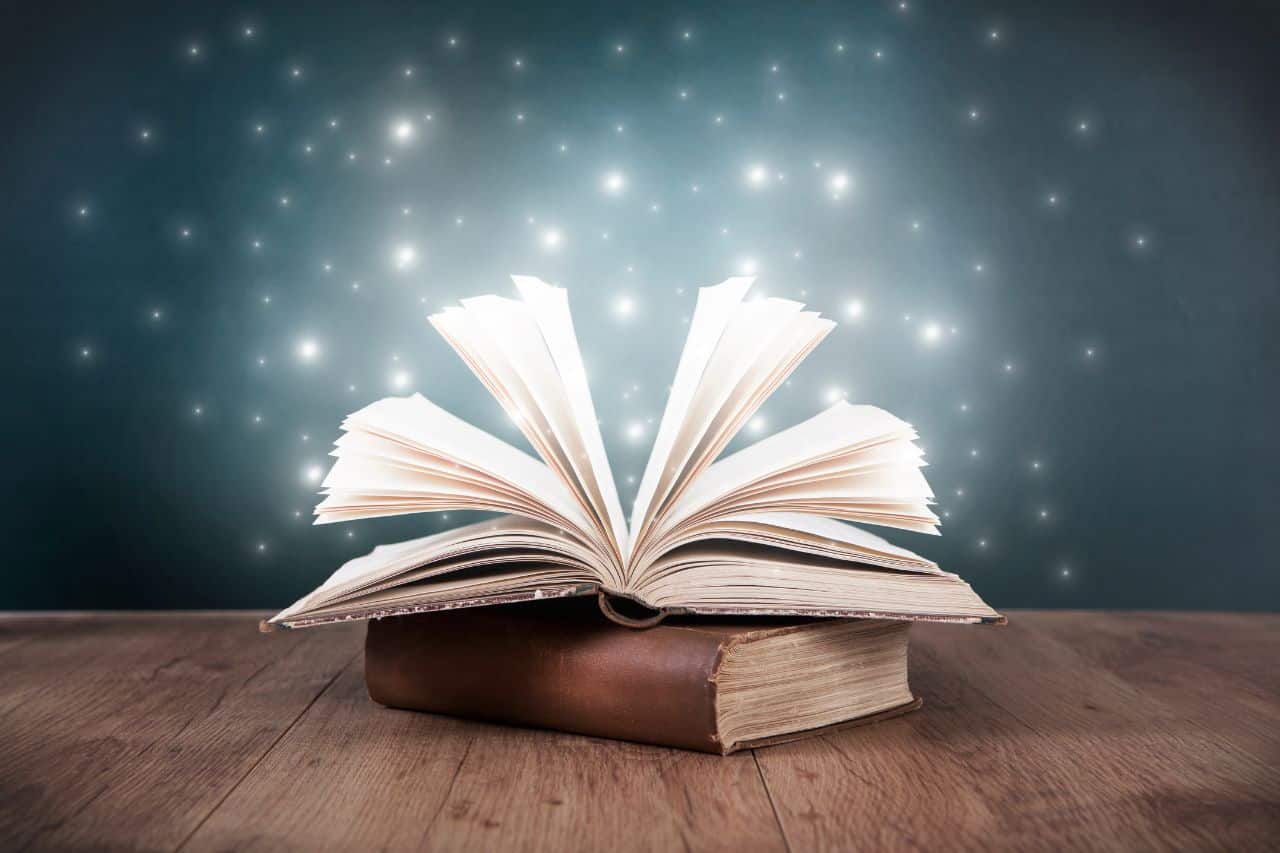Cet exemple d’État de lard dans mémoire de fin d’études vise à vous donner une visibilité sur les attentes académique pratiques relatives à la rédaction de cette partie du mémoire.
Aujourd’hui, les technologies numériques sont une composante constante de la société et de leurs activités, avec les Smartphones, les réseaux d’information mondiaux et la réalité virtuelle comme présences standard dans la vie quotidienne ; déterminant ainsi l’ensemble de la société à devenir significativement dépendante des technologies numériques et de leurs infrastructures spécifiques. Ces nouvelles technologies ont commencé à changer le monde dans les années cinquante, de l’introduction des premiers ordinateurs, serveurs clients et ordinateurs personnels, Web 1.0 et e-commerce, aux technologies modernisées du 21ème siècle, comme le Web 2.0 et les systèmes de stockage de données, les données mobiles, les visualisations, le Big data et l’analytique, l’Internet des objets (IoT) et, plus récemment, l’intelligence artificielle1.
Tous ces changements technologiques impliquent des changements transformateurs dans la dimension du capital humain, tant du point de vue de la création et du développement de la technologie que du point de vue attribué au rôle de l’utilisateur de ces nouvelles technologies. Le capital humain doit accumuler de nouvelles compétences comprenant des compétences techniques générées par l’interaction homme-machine et des transformations comportementales qui incluent de nouvelles capacités sur les relations interhumaines dans l’espace virtuel, des compétences de communication, des compétences éthiques et de responsabilité.
Depuis des années cinquante, les technologies de l’information et de la communication ont changé la perspective et les moyens de vivre et de travailler, ayant le plus grand impact sur la tendance des processus d’automatisation et d’ingénierie. Néanmoins, en un temps limité, la technologie et ses applications sont devenues accessibles à tous et à tous les secteurs de l’économie, soulignant le monde dépassé dans lequel nous vivions, un monde régi par des pratiques et processus commerciaux dépassés, une ségrégation au sein de la société. , consommation et traitement inefficaces de l’information, dimensions et structures de travail obsolètes, etc. La grande vague de cloud computing n’a fait qu’ajouter aux avantages déterminés par ce changement structurel et fonctionnel – l’hyperconnexion a démontré que les affaires, le travail, les gens changent pour le bien parallèlement à la technologie2. Par la suite, l’innovation représente le chaînon manquant dans le tableau, en tant que source de toutes ces avancées technologiques dans tous les secteurs de l’économie, modélisant de nouvelles perspectives dans la transformation des connaissances.
De fait de ces différents facteurs de changement, la question principale reste de savoir comment tous ces éléments ont réellement façonné le capital humain et sa productivité, les liens possibles entre la vague de numérisation et l’environnement de travail, l’impact critique du cloud sur le capital humain et ses résultats par rapport aux compétences et aptitudes humaines, etc.
Il est déjà évident que dans les conditions de la numérisation, la transformation du marché du travail, la gestion du développement du capital humain devient un facteur décisif de croissance et d’augmentation de la compétitivité, dont la base est une économie innovante basée sur la connaissance.
Également, les avancées technologiques ainsi que les pressions concurrentielles obligent les entreprises non seulement à assurer leur production, mais aussi à trouver des moyens pour s’adapter aux nouvelles exigences du marché. La recherche d’avantages compétitifs constitue une obligation pour faire face à la concurrence. Dans cette optique, les ressources humaines pourraient être considérées comme étant un élément clé de la performance. D’autre part, ces personnes doivent également détenir tous les savoirs et les compétences requises pour accomplir leurs missions au sein de l’entreprise. Puis, chaque personne devrait également détenir sa place et accomplir une mission particulière qui va dans le sens de l’augmentation de la performance de l’entreprise.
Tous ces constats nous amènent dans la cadre de ce travail à nous intéresser à la place du capital humain dans un contexte d’évolution numérique. La problématique que nous avons choisi est la suivante : « La Digitalisation de l’économie : OU est la place de l’humain dans cette course à la digitalisation ?, La France est-elle prête ? ».
PARTIE I
- LA DIGITALISATION DE L’ECONOMIE
- Comment est organisée la digitalisation dans l’entreprise en général
La numérisation en tant que telle est passée d’une forme d’évolution technique à un phénomène qui peut avoir un impact sur tout type d’organisation. Les mondes physique et numérique convergent de plus en plus fréquemment et doivent travailler ensemble, afin que les entreprises puissent devenir numériques3. Cela peut se produire, par exemple, en intégrant l’Internet des objets et des services dans les processus industriels et en générant de la valeur en analysant et en gérant des données qui peuvent être utilisées comme source d’avantages concurrentiel4s. Ainsi, de nombreux changements induits par la digitalisation sont disruptifs et modifient complètement les modèles existants. Les entreprises qui ont dominé le marché sont confrontées à de nouveaux concurrents qui redéfinissent les industries établies de sorte que les business modèles existants deviennent obsolètes et sont remplacés par de nouveaux5.
Numérisation ou digitalisation ? Quelle est la différence ? La première tient à la confusion de son sens. Comme le dit Moatti, A. (2016), en français, la différence sémantique réside dans le fait que l’on parlera davantage du numérique (par opposition à l’analogique) pour désigner les supports de l’évolution technologique, sa matérialité, tandis que le digital et la digitalisation seraient des termes plus utilisés pour décrire les expériences qui provoquent ces matérialités. Bien que dans les discours cette différence ne soit pas si nette, cette première réflexion montre la complexité de l’analyse engendrée par ce phénomène technologique en assimilant causes, moyens et conséquences, posant également le problème du point focal avec lequel ce phénomène digital/numérique est appréhendé.
Le deuxième problème est que le terme « digitalisation » est souvent utilisé dans des discours insinuant une rupture dans l’évolution technologique. Une « révolution » est annoncée (en fait, beaucoup parlent de la quatrième révolution industrielle). D’un point de vue historique et anthropologique, la numérisation s’inscrit dans une dynamique évolutive et continue de l’homme envers les techniques qu’il crée. Cependant, la dynamique technologique actuelle, dont le tournant a commencé avec l’arrivée des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), dessine une trajectoire exponentielle tant en ampleur qu’en vitesse. En effet, certains auteurs montrent à quel point le phénomène numérique se déroule de manière continue et disruptive, illustrant la complexité de sa lecture historique.6
Afin de mieux comprendre les raisons qui ont poussé les entreprises à se convertir dans la digitalisation, il est important de comprendre l’évolution de cette digitalisation dans la société en général et dans la vie de tous les jours.
Dans le discours sur le développement technologique, on parle généralement de la technologie comme si elle fonctionnait indépendamment des gens, le développement, l’innovation et le changement technologique sont pris pour acquis, comme si les gens et la société étaient de simples spectateurs du spectacle technologique. Or, d’un point de vue éco-systémique, le changement technologique n’est possible que s’il s’accompagne d’un changement socioculturel, et donc des habitudes, coutumes, comportements et coexistence de tous les acteurs sociaux concernés.
Depuis l’émergence du terme digitalisation, les effets de la digitalisation sur la société sont au cœur des débats. Nambisan, S., Lyytinen, K., Majchrzak, A.,& Song, M. (2017) décrivent les implications de la numérisation sur la société, dans le contexte de la lutte contre les objections et la possibilité d’une exploration assistée par ordinateur des phénomènes sociaux. L’étude et l’exploration du concept de numérisation ont produit d’énormes quantités de littérature, soulignant la manière dont la structure des médias numériques façonne et influence le monde moderne. Dans ce contexte, la numérisation a commencé à aborder la structuration de divers domaines de la vie sociale autour de la communication numérique et des infrastructures médiatiques.7
Actuellement, rien n’est plus représentatif de cette prémisse que tout ce qui concerne Internet. Se déplacer est une particularité des groupes sociaux dans la modernité et de l’individu dans la postmodernité, mais se déplacer en ligne est la marque de notre époque. Les TIC, ainsi qu’Internet sont les filles de ce processus d’annihilation de l’espace par le temps. Ce n’est que dans un système où il y avait une réduction du temps de rotation du capital, une accélération du temps de rotation de la production et une réduction du temps de rotation de la consommation qu’une technologie basée sur la philosophie de l’échange d’informations a pu émerger.
Internet, les TIC sont donc éminemment une ontologie du mouvement intimement liée au processus de consommation et à son fonctionnement. Actuellement, les personnes de moins de 25 ans sont les plus grands utilisateurs des TIC et d’Internet. Ils dépendent largement de leur accès pour les missions scolaires et professionnelles, les consultations par Internet sont leur principal moyen d’information. Cependant, le rôle principal des TIC réside dans les possibilités de socialisation et d’accès aux différentes formes de divertissement8.
Cette génération est la première à être formée et à développer ses compétences cognitives et ses processus d’inculturation grâce à l’utilisation intensive des TIC. Cette génération est appelée les natifs du numérique. Le modèle communicatif et de consommation des digitales natives combinent les caractéristiques suivantes 9:
- Intégration : la technologie est combinée à des moyens créatifs pour générer de nouvelles formes d’expression hybrides ;
- Interactivité : l’utilisateur manipule et influence directement son expérience avec les médias, et à travers eux établit une communication avec les autres ;
- Multicanal : la création d’une trace propre d’interconnexions entre les composants selon la volonté de l’utilisateur ;
- Immersion : l’utilisateur navigue en immersion entre des formes et des présentations non linéaires issues des stratégies esthétiques et formelles issues des processus précédents.
Les natifs numériques mènent simultanément différentes activités en ligne, qui peuvent combiner productivité, loisirs et divertissement, et ils s’impliquent davantage dans des environnements interactifs, tels que les jeux virtuels de nouvelle génération. Le vrai sens de la réalité pour les natifs numériques est la façon dont ils ont effectué leur apprentissage culturel. Ils ont appris à vivre grâce à l’utilisation de la technologie numérique, ont grandi avec une vision qui intègre des tâches mentales multiples et parallèles et préfèrent traiter l’information par des images et des sons plutôt que par du texte.
De leur côté, les « migrants numériques », âgés de plus de 25 ans, ont intériorisé le monde des TIC comme un monde dans lequel ils n’ont pas appris à vivre, mais ils les ont plutôt approchés et adaptés.
Les nouveaux réseaux sociaux, phénomène émergent de l’internet, que ORLIKOWSKI, W.J., & SCOTT, S.V. (2014) a qualifié de Réseaux Sociaux de Second Ordre tant pour leur positionnement historique que pour leur contingence et virtualité, reflètent mieux l’idée d’adaptation, puisqu’ils sont des entités ouvertes, indéterminées, fluctuantes et en constante transformation.
Depuis l’avènement d’internet et la prolifération plus récente de l’utilisation des réseaux sociaux, comme Facebook et Twitter, dans la vie quotidienne des gens, des domaines dans lesquels les chercheurs consommateurs se sentaient autrefois à l’aise, comme la culture matérielle, la circulation des marchandises le prestige, les identités, etc., sont devenus diffus et des éléments ont été incorporés qui rendent encore plus complexe la tâche de retracer les traces de la consommation.
Les natifs comme les migrants numériques se réinventent dans les réseaux sociaux, bien qu’à des rythmes très différents, et établissent ainsi de nouvelles formes de participation sociale dans une sorte de paradoxe qui traverse l’action humaine et les contradictions intrinsèques au système économique qui la rend possible.
- Les impacts de la digitalisation au niveau de la société
Analyser les opportunités offertes par la numérisation, mais aussi les risques ou défis que ces changements peuvent avoir dans notre environnement nous semble important, compte tenu des circonstances actuelles. Les lacunes dans l’accès, l’utilisation et l’apprentissage des technologies numériques peuvent générer des inégalités importantes et réveiller de nouvelles formes d’exclusion.
La numérisation provoque différents impacts que ce soit au niveau social ou professionnel et dont les plus importants sont les suivants 10:
- Les barrières et les difficultés que les personnes peuvent rencontrer dans les processus de numérisation, et les nouvelles compétences et aptitudes qu’elles sont censées acquérir, pour rester actives et incluses dans le nouveau modèle économique et social ;
- Les alternatives d’impact positif et les tendances que la numérisation peut offrir, pour promouvoir le monde du travail, comme le télétravail et son impact sur la mobilité géographique de l’emploi ;
- Des effets d’exclusions pour les personnes âgées, en particulier les personnes âgées de plus de 45 ans.
Au cours de la dernière décennie, nous avons été témoins d’idées qui mettent en évidence des changements radicaux dans la production de la culture et du savoir. Ils soutiennent que dans un monde dominé par les plateformes numériques (telles que Facebook, Twitter et Wikipédia), des formes entièrement nouvelles de production de connaissances et de culture non commercialisables et non exclusives ont émergé en raison de l’accessibilité unique des technologies numériques, qui ont changé les modes et les critères de création de sociabilité11. L’essor des médias numériques entraîne, entre autres, le faible coût de création et de diffusion de la quasi-totalité de l’information numérique, qu’il s’agisse de films sur Smartphones ou de commentaires politiques sur des blogs. La numérisation doit être abordée de manière critique en raison de ses propriétés perturbatrices, et outre les opportunités, les défis et les dangers qu’elle apporte doivent être soulignés.
Egalement, la généralisation des plateformes d’achats en ligne ou places de marché numériques permet de disposer d’informations et de services qui font gagner du temps et qui, en plus, facilitent l’accès à des produits et services à des prix compétitifs.
La croissance continue de l’utilisation des technologies numériques entraîne de profonds changements dans toute la société en interconnectant des milliards de personnes, de machines et de produits. Ces changements doivent aller de pair avec des changements tout aussi importants de l’économie et donc du tissu des entreprises, des administrations publiques et des citoyens en général. La transformation numérique agit de manière transversale dans la société, l’économie et dans notre vie quotidienne, devenant un accélérateur de ce changement. Le développement social et commercial est exponentiel et tous deux sont des éléments essentiels et différenciateurs dans un monde de plus en plus global et ouvert. La transformation numérique élimine les frontières entre les produits et les services, raccourcit leurs cycles de vie et augmente les attentes des clients.
La transformation numérique peut être définie comme un ensemble d’actions visant à améliorer et à moderniser les processus, les procédures, les habitudes et les comportements des organisations et des personnes qui, en utilisant les technologies numériques, améliorent la compétitivité globale12. La transformation numérique oblige les organisations à revoir leurs modèles commerciaux, leurs opérations et leur stratégie technologique, ce qui implique un changement culturel qui doit être mené par la haute direction. La transformation numérique peut également être considérée comme l’intégration de la technologie numérique dans tous les domaines d’une entreprise, modifiant fondamentalement la façon dont elle fonctionne et offre de la valeur à ses clients. C’est aussi un changement culturel qui oblige les organisations à constamment remettre en question le statu quo, à expérimenter et à se sentir à l’aise avec l’échec. La transformation numérique peut impliquer de retravailler les produits, les processus et les stratégies au sein de l’organisation en tirant parti de la technologie numérique13.
En tant que telle, la transformation numérique nécessite un examen et une réinvention de la plupart, sinon de tous les domaines au sein d’une organisation, de sa chaîne d’approvisionnement et de son flux de travail, des compétences de ses employés ainsi que des processus de discussion au niveau du conseil d’administration, des interactions avec les clients et de leur valeur pour les parties prenantes14.
La transformation numérique aide une organisation à suivre le rythme des demandes émergentes des clients, en les maintenant dans le futur. La transformation numérique permet aux organisations d’être plus compétitives dans un environnement économique en constante évolution à mesure que la technologie évolue. À cette fin, la transformation numérique est nécessaire pour toute entreprise, organisation à but non lucratif ou institution cherchant à survivre dans le futur.
Toutefois, il ne faut pas comprendre la transformation numérique d’une organisation simplement comme la mise en œuvre du numérique sur certaines pratiques ou processus. La transformation numérique doit tirer parti du potentiel des technologies numériques pour réinventer l’organisation elle-même de manière à ce qu’elle adapte ses processus, ses produits et ses modèles commerciaux à la demande des utilisateurs, des consommateurs et des employés qui sont de plus en plus éminemment numériques. Dans ce contexte, la transformation numérique n’est plus une stratégie pour l’avenir, mais offre plutôt un avantage concurrentiel qui peut être non seulement pratique, mais essentiel pour la survie.15
Dans le monde d’aujourd’hui, les entreprises sont construites par des processus innovants, en essayant de développer des processus de haut niveau. Par conséquent, des outils sont conçus pour affiner et améliorer ces processus afin de créer une efficacité, une concentration et une amélioration de la qualité. En revanche, la transformation numérique supprime les processus qu’une entreprise effectue ou pourrait effectuer aujourd’hui, automatise le travail effectué par les employés et transforme le processus en logiciel. Ce qui reste, ce sont les données16.
Le numérique transforme les processus en données. Cela permet aux organisations de voir leur activité à travers le prisme des données plutôt que le prisme des processus. Ainsi, les données montrent clairement que les gens comptent et que l’expérience client compte. Par exemple, au lieu de voir le service client comme un ensemble de processus initiés par le client ou l’organisation, ce sont les données client qui obligent l’organisation à réfléchir à l’expérience client17. Un concept global gère non seulement des données produit isolées, mais intègre également des applications, des interfaces et des processus au-delà des unités organisationnelles d’une entreprise. Les données et informations sur les produits et leur processus de fabrication sont ainsi disponibles et toujours à jour.
Au fur et à mesure que les données et la capacité d’associer ces données à des indicateurs ou à des problèmes émergent, une organisation peut non seulement devenir plus efficace, mais aussi changer ce qu’elle fait. L’impact commercial qui résulte de la vision du monde à travers une lentille de données plutôt qu’une lentille de processus est très puissant.
La digitalisation est venue configurer ce qu’on peut appeler une culture numérique, dont l’importance se limite à deux domaines. Premièrement, elle permet l’homogénéisation de l’information pour son stockage, son traitement et son transport. Ensuite, il y a l’utilisation du langage binaire qui contribue au passage de l’environnement analogique au numérique, permettant la naissance d’une nouvelle catégorie de traitement qui est la dématérialisation.
Ainsi, l’élément le plus simple du monde numérique a engendré une complexité et des conséquences inattendues à l’échelle humaine tout entière. Cependant, formant des réseaux, les ordinateurs servent non seulement à traiter des informations stockées sur des supports physiques dans n’importe quel format numérique, mais aussi comme outils pour accéder à des informations, des ressources et des services fournis par des ordinateurs distants, tels que des systèmes de publication et de diffusion d’informations et comme moyen de communication entre êtres humains. L’exemple par excellence des réseaux informatiques est Internet : un réseau de réseaux qui interconnecte des millions de personnes, d’institutions, d’entreprises, etc. à travers le monde.
La raison fondamentale pour laquelle les technologies de l’information et de la communication deviennent un facteur de compétitivité, c’est-à-dire d’amélioration constante, d’innovation et une source de productivité pour les différentes entités de la société, en particulier pour la gestion des entreprises, est liée à ses potentialités : immatérialité, interactivité, instantanéité, innovation, paramètres de haute qualité d’image et de son, numérisation, influence sur les processus plus que sur les produits, interconnexion, flexibilité et diversité 18:
- L’immatérialité : l’immatérialité peut être conçue à partir d’une double configuration : sa matière première est l’information et la facilité qu’ont certaines d’entre elles à construire des messages sans références extérieures. Cela élargit les marges de génération et de traitement de l’information, comme c’est le cas de l’utilisation des technologies de l’information ; permet l’accès à de grands volumes d’informations et dans des délais courts ; présente les mêmes informations à l’utilisateur avec des codes linguistiques différents, et transmet des informations vers des destinations lointaines, avec des coûts de plus en plus faibles et en temps réel ;
- L’interactivité : une autre caractéristique significative est l’interactivité, puisque les TIC permettent à l’utilisateur non seulement de créer des messages (activité qui peut également être réalisée avec d’autres technologies plus traditionnelles), mais aussi de décider de la séquence d’informations à suivre et d’établir la quantité et la portée des informations à transmettre ;
- L’instantanéité : l’une des exigences des entreprises, notamment de la direction, est de recevoir l’information dans les meilleures conditions techniques possible et dans les délais les plus courts, de préférence en temps réel. Ces demandes peuvent être satisfaites avec les TIC, car elles permettent l’instantanéité de l’information, brisant les barrières temporelles et spatiales, comme le fait la communication par satellite. Ceci, à la fois, est une caractéristique et un facteur d’accélération de la relation globale locale puisque l’utilisateur peut accéder à des bases de données localisées dans le monde entier ;
- La connectivité : le concept de connectivité a un sens très large. Avec cela, le réseau a créé un nouvel espace universel d’informations partagées, avec un facteur complètement nouveau : la capacité de trouver des informations et de regrouper des personnes ayant des intérêts communs ;
- L’innovation : il n’est pas nouveau de souligner que ces technologies sont associées à l’innovation. En principe, toute nouvelle technologie a pour objectif l’amélioration, le changement et l’amélioration qualitative et quantitative de la technologie précédente et, par conséquent, des fonctions qu’elle remplissait ;
- La diversité : la dernière caractéristique qui mérite d’être relevée est la diversité, celle-ci doit être comprise d’un double point de vue : premièrement, au lieu de trouver des technologies unitaires, nous avons des technologies qui s’articulent autour de certaines des caractéristiques mentionnées ; et deuxièmement, il existe une diversité de fonctions que les technologies peuvent remplir, de celles qui transmettent exclusivement des informations à celles qui permettent une interaction entre les utilisateurs, ce qui les rend flexibles.
Bien que la numérisation prenne des formes différentes, elle trouve souvent une configuration où les artefacts numériques s’instaurent comme de nouvelles instances d’intelligibilité et de nouvelles instances de corporalité dans le travail réel19. De nouvelles instances où les travailleurs ont peu de place pour l’action et l’appropriation.
La transformation numérique a engendré d’importants impacts au niveau de tous les métiers, manuels, intellectuel, métiers de la connaissance ou de l’expérience. Cet important changement nécessite également le développement et l’acquisition de nouvelles compétences. Depuis le développement conséquent des nouvelles technologies de l’information et de la communication, de nouveaux métiers sont apparus et d’autres commencé à disparaitre. Les différentes spécificités, ainsi que les difficultés se rapportant à l’adaptation par rapport aux évolutions traditionnelles de l’entreprise et l’utilisation des nouveaux outils de travail tiennent à ce que la rapidité de la diffusion implique un niveau d’adaptation et d’anticipation élevé pour qu’il n’y ait pas de déqualification.
Les nouvelles formes d’organisation sont établies en fonction de plusieurs choix stratégiques se présentant à l’entreprise. Ces nouvelles formes d’organisation peuvent également apparaitre au niveau plus bas de la structure organisationnelle, par exemple au niveau d’une division, d’un service, etc. Mais quelle que soit la situation, il est toujours question de viser deux impératifs pour bénéficier de plus de performance :
- une plus grande flexibilité opérationnelle permettant de faire évoluer la division des activités vers une redéfinition des frontières entre les entités ;
- une mobilisation importante de chaque acteur concerné afin d’atteindre la performance et faire évoluer la coordination vers plus d’implication.
En développant des systèmes artificiellement intelligents, basés sur des algorithmes et des réseaux, qui traitent et diffusent l’information de manière autonome, une forme de « prolétarisation du savoir » se construit (Stiegler cité par Salini et al.). Ceux qui étaient jusqu’alors experts dans leur propre métier, perdent le pouvoir de décision et deviennent partie, ou composante, d’un nouveau système de travail porté par ces nouveaux objets. Ces systèmes intelligents reposent également sur la notion de réseaux et d’apprentissage. Beaucoup reposent sur la collecte, l’interprétation et l’extrapolation des données saisies par les utilisateurs ou les clients eux-mêmes. Ainsi, de nouvelles formes de co-services se construisent. Le client prend une partie de l’activité de construction du service, mais enlève ainsi une partie du contrôle à l’opérateur. Ainsi, une partie du travail est externalisée (Leduc & Ponge, Pinheiro et al.).
1 France stratégie, « Vision prospective partagée des emplois et des compétences – la filière numérique », juin 2021
2 Jullien, F. « Les transformations silencieuses ». Chantiers, I, Grasset, 2009
3 Manuti, A., & DE palma, P.D. (2018). Digital HR: A Critical Management Approach to the Digitalization of Organizations. Palgrave MacMillan.
4 DUDÉZERT, A. (2018). La transformation digitale des entreprises. Repères La Découverte.
5 Pointeau, B. (2015). « La nouvelle réalité du monde commercial face au digital », Bain &Company, disponible sur journaldunet.com
6 Moatti, A. (2016), « Le numérique rattrapé par le digital ? ». Le Débat, <halshs- 01720052>.
7 Nambisan, S., Lyytinen, K., Majchrzak, A.,& Song, M. (2017). Digital Innovation Management: Reinventing Innovation Management Research in a Digital World. MIS Quarterly, 41(1), p. 223-238.
8 Pointeau, B. (2015). « La nouvelle réalité du monde commercial face au digital », Bain &Company, disponible sur journaldunet.com
9 ORLIKOWSKI, W.J., & SCOTT, S.V. (2014). What happens when evaluation goes online?: exploring apparatuses of valuation in the travel sector. Organization Science, 25(3). p. 868-891.
10 Pierre Musso, 2010, « La Revolution Numerique : Techniques Et Mythologies », HAL, La Pensée
11 Valenduc, G., & Vendramin, P. (2017), “Digitalisation, between disruption and evolution”. Transfer: European Review of Labour and Research, 23(2), p. 121-134.
12 Valenduc, G., & Vendramin, P. (2017), “Digitalisation, between disruption and evolution”. Transfer: European Review of Labour and Research, 23(2), p. 121-134.
13 Pointeau, B. (2015). « La nouvelle réalité du monde commercial face au digital », Bain &Company, disponible sur journaldunet.com
14 Meyenberg, Ute. (2018). Entreprise du futur : les enjeux de la transformation numérique des entreprises. Terminal. 10.4000/terminal.2215.
15 Meyenberg, Ute. (2018). Entreprise du futur : les enjeux de la transformation numérique des entreprises. Terminal. 10.4000/terminal.2215.
16 Dussart, Christian. (2017). Transformation numérique des entreprises : faites-en votre priorité !. Gestion. 42. 86. 10.3917/riges.422.0086.
17 Dussart, Christian. (2017). Transformation numérique des entreprises : faites-en votre priorité !. Gestion. 42. 86. 10.3917/riges.422.0086.
18 Moatti, A. (2016), « Le numérique rattrapé par le digital ? ». Le Débat, <halshs- 01720052>.
19 Manuti, A., & DE palma, P.D. (2018). Digital HR: A Critical Management Approach to the Digitalization of Organizations. Palgrave MacMillan.